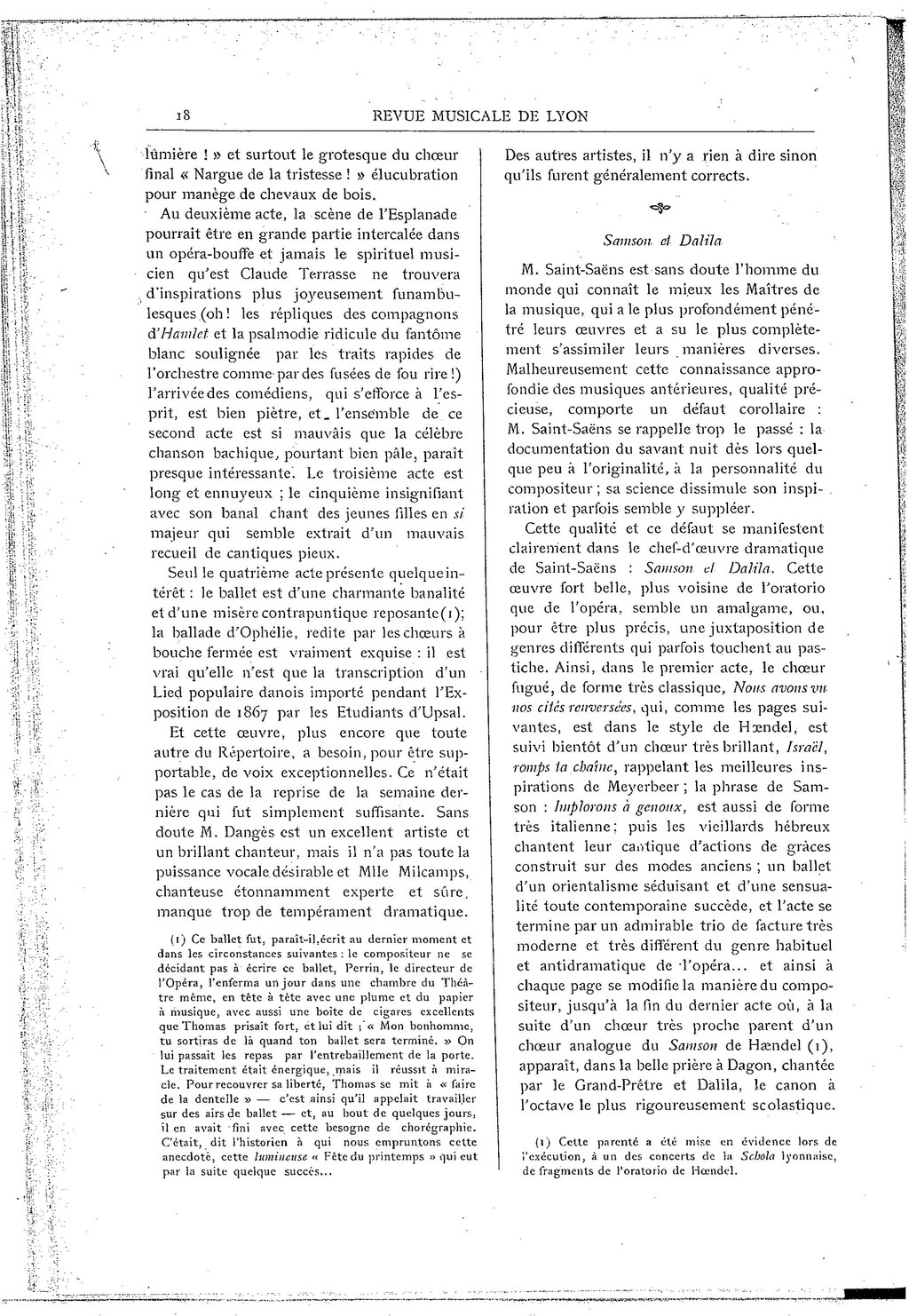lumière ! » et surtout le grotesque du chœur final « Nargue de la tristesse ! » élucubration pour manège de chevaux de bois.
Au deuxième acte, la scène de l’Esplanade pourrait être en grande partie intercalée dans un opéra-bouffe et jamais le spirituel musicien qu’est Claude Terrasse ne trouvera d’inspirations plus joyeusement funambulesques (oh ! les répliques des compagnons d’Hamlet et la psalmodie ridicule du fantôme blanc soulignée par les traits rapides de l’orchestre comme par des fusées de fou rire !) l’arrivée des comédiens, qui s’efforce à l’esprit, est bien piètre, et l’ensemble de ce second acte est si mauvais que la célèbre chanson bachique, pourtant bien pâle, parait presque intéressante. Le troisième acte est long et ennuyeux ; le cinquième insignifiant avec son banal chant des jeunes filles en si majeur qui semble extrait d’un mauvais recueil de cantiques pieux.
Seul le quatrième acte présente quelque intérêt : le ballet est d’une charmante banalité et d’une misère contrapuntique reposante[1] ; la ballade d’Ophélie, redite par les chœurs à bouche fermée est vraiment exquise : il est vrai qu’elle n’est que la transcription d’un Lied populaire danois importé pendant l’Exposition de 1867 par les Étudiants d’Upsal.
Et cette œuvre, plus encore que toute autre du Répertoire, a besoin, pour être supportable, de voix exceptionnelles. Ce n’était pas le cas de la reprise de la semaine dernière qui fut simplement suffisante. Sans doute M. Dangès est un excellent artiste et un brillant chanteur, mais il n’a pas toute la puissance vocale désirable et Mlle Milcamps, chanteuse étonnamment experte et sûre, manque trop de tempérament dramatique. Des autres artistes, il n’y a rien à dire sinon qu’ils furent généralement corrects.
M. Saint-Saëns est sans doute l’homme du monde qui connaît le mieux les Maîtres de la musique, qui a le plus profondément pénétré leurs œuvres et a su le plus complètement s’assimiler leurs manières diverses. Malheureusement cette connaissance approfondie des musiques antérieures, qualité précieuse, comporte un défaut corollaire : M. Saint-Saëns se rappelle trop le passé : la documentation du savant nuit dès lors quelque peu à l’originalité, à la personnalité du compositeur ; sa science dissimule son inspiration et parfois semble y suppléer.
Cette qualité et ce défaut se manifestent clairement dans le chef-d’œuvre dramatique de Saint-Saëns : Samson et Dalila. Cette œuvre fort belle, plus voisine de l’oratorio que de l’opéra, semble un amalgame, ou, pour être plus précis, une juxtaposition de genres différents qui parfois touchent au pastiche. Ainsi, dans le premier acte, le chœur fugué, de forme très classique, Nous avons vu nos cités renversées, qui, comme les pages suivantes, est dans le style de Hændel, est suivi bientôt d’un chœur très brillant, Israël, romps ta chaîne, rappelant les meilleures inspirations de Meyerbeer ; la phrase de Samson : Implorons à genoux, est aussi de forme très italienne ; puis les vieillards hébreux chantent leur cantique d’actions de grâces construit sur des modes anciens ; un ballet d’un orientalisme séduisant et d’une sensualité toute contemporaine succède, et l’acte se termine par un admirable trio de facture très moderne et très différent du genre habituel et antidramatique de l’opéra… et ainsi à chaque page se modifie la manière du compositeur, jusqu’à la fin du dernier acte où, à la suite d’un chœur très proche parent d’un chœur analogue du Samson de Hændel[2], apparaît, dans la belle prière à Dagon, chantée par le Grand-Prêtre et Dalila, le canon à l’octave le plus rigoureusement scolastique.
- ↑ Ce ballet fut, paraît-il, écrit au dernier moment et dans les circonstances suivantes : le compositeur ne se décidant pas à écrire ce ballet, Perrin, le directeur de l’Opéra, l’enferma un jour dans une chambre du Théâtre même, en tête à tête avec une plume et du papier à musique, avec aussi une boîte de cigares excellents que Thomas prisait fort, et lui dit : « Mon bonhomme, tu sortiras de là quand ton ballet sera terminé. » On lui passait les repas par l’entrebâillement de la porte. Le traitement était énergique, mais il réussit à miracle. Pour recouvrer sa liberté, Thomas se mit à « faire de la dentelle » — c’est ainsi qu’il appelait travailler sur des airs de ballet — et, au bout de quelques jours, il en avait fini avec cette besogne de chorégraphie. C’était, dit l’historien à qui nous empruntons cette anecdote, cette lumineuse « Fête du printemps » qui eut par la suite quelque succès…
- ↑ Cette parenté a été mise en évidence lors de l’exécution, à un des concerts de la Schola lyonnaise, de fragments de l’oratorio de Hændel.