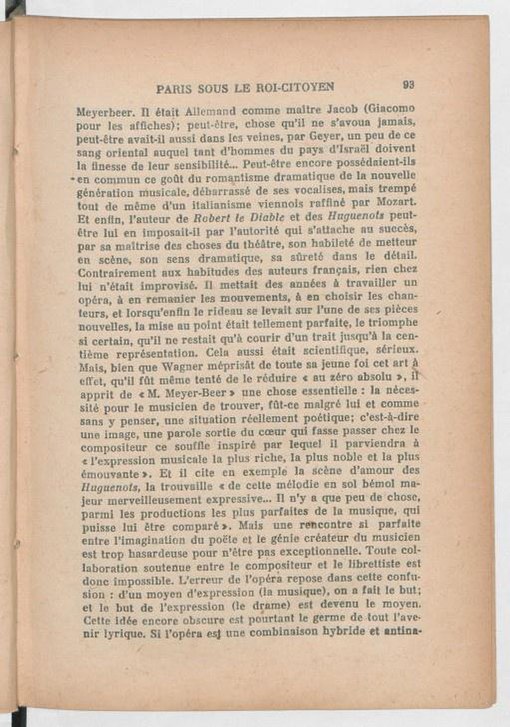Meyerbeer. Il était Allemand comme maître Jacob (Giacomo
pour les affiches) ; peut-être, chose qu’il ne s’avoua jamais,
peut-être avait-il aussi dans les veines, par Geyer, un peu de ce
sang oriental auquel tant d’hommes du pays d’Israël doivent
la finesse de leur sensibilité… Peut-être encore possédaient-ils
en commun ce goût du romantisme dramatique de la nouvelle
génération musicale, débarrassé de ses vocalises, mais trempé
tout de même d’un italianisme viennois raffiné par Mozart.
Et enfin, l’auteur de Robert le Diable et des Huguenots peut-être
lui en imposait-il par l’autorité qui s’attache au succès,
par sa maîtrise des choses du théâtre, son habileté de metteur
en scène, son sens dramatique, sa sûreté dans le détail.
Contrairement aux habitudes des auteurs français, rien chez
lui n’était improvisé. Il mettait des années à travailler un
opéra, à en remanier les mouvements, à en choisir les chanteurs,
et lorsqu’enfin le rideau se levait sur l’une de ses pièces
nouvelles, la mise au point était tellement parfaite, le triomphe
si certain, qu’il nc restait qu’à courir d’un trait jusqu’à la centième
représentation. Cela aussi était scientifique, sérieux.
Mais, bien que Wagner méprisât de toute sa jeune foi cet art à
effet, qu’il fût même tenté de le réduire « au zéro absolu », il
apprit de « M. Meyer-Beer » une chose essentielle : la nécessité
pour le musicien de trouver, fût-ce malgré lui et comme
sans y penser, une situation réellement poétique ; c’est-à-dire
une image, une parole sortie du cœur qui fasse passer chez le
compositeur ce souffle inspiré par lequel il parviendra à
« l’expression musicale la plus riche, la plus noble et la plus
émouvante ». Et il cite en exemple la scène d’amour des
Huguenots, la trouvaille « de cette mélodie en sol bémol majeur
merveilleusement expressive… Il n’y a que peu de chose,
parmi les productions les plus parfaites de la musique, qui
puisse lui être comparé ». Mais unc rencontre si parfaite
entre l’imagination du poëte et le génie créateur du musicien
est trop hasardeuse pour n’être pas exceptionnelle. Toute collaboration
soutenue entre le compositeur et le librettiste est
donc impossible. L’erreur de l’opéra repose dans cette confusion :
d’un moyen d’expression (la musique), on a fait le but ;
et le but de l’expression (le drame) est devenu le moyen.
Cette idée encore obscure est pourtant le germe de tout l’avenir
lyrique. Si l’opéra est une combinaison hybride et antina-
Page:Pourtalès - Wagner, histoire d'un artiste, 1948.pdf/111
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
93
PARIS SOUS LE ROI-CITOYEN