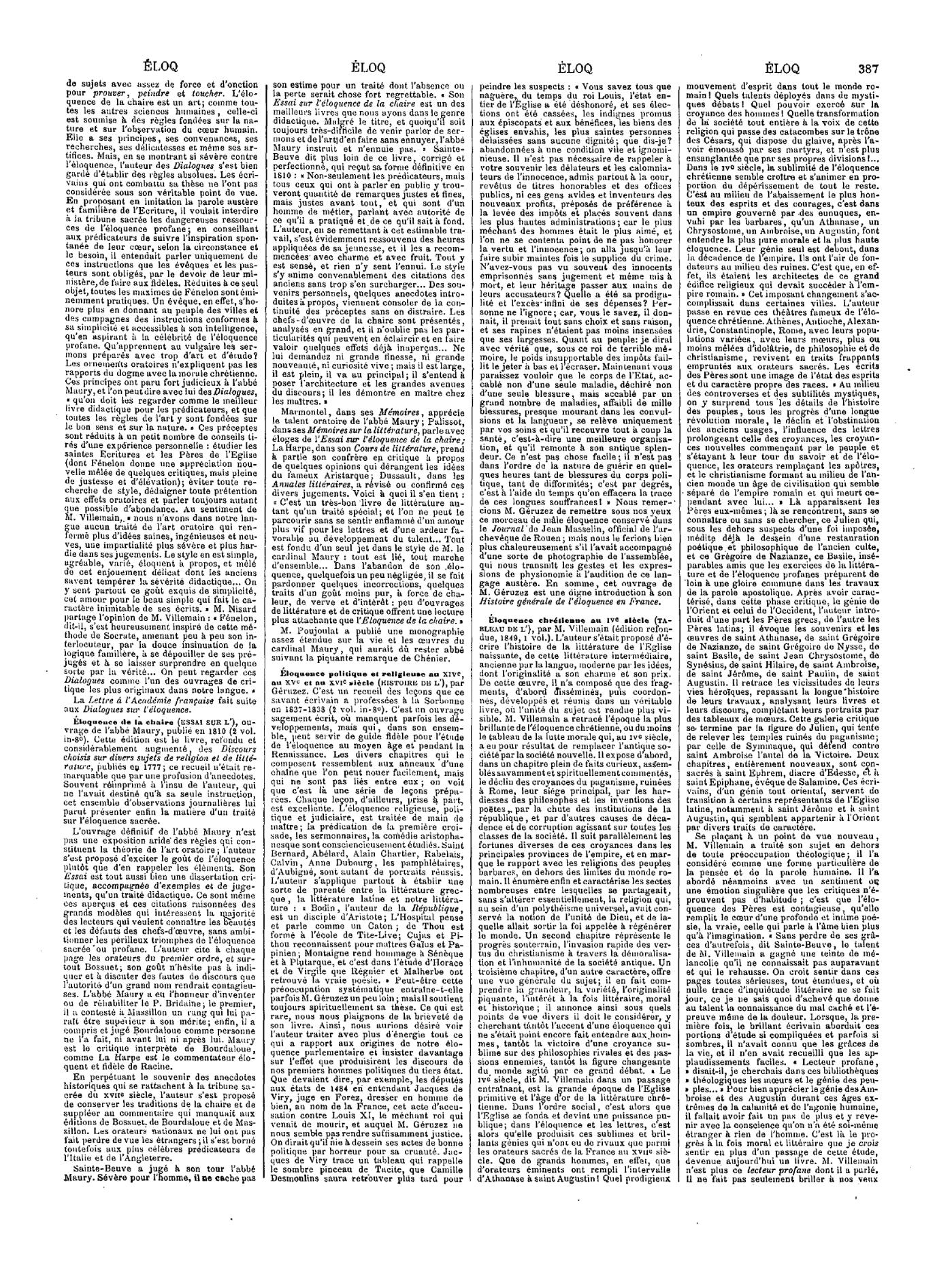de sujets avec assez de force et d’onction pour prouver, peindre et toucher. L’éloquence de la chaire est un art ; comme toutes les autres sciences humaines, celle-ci est soumise à des règles fondées sur la nature et sur l’observation du cœur humain. Elle a ses principes, ses convenances, ses recherches, ses délicatesses et même ses artifices. Mais, en se montrant si sévère contre l’éloquence, l’auteur des Dialogues s’est bien gardé d’établir des règles absolues. Les écrivains qui ont combattu sa thèse ne l’ont pas considérée sous son véritable point de vue. En proposant en imitation la parole austère et familière de l’Ecriture, il voulait interdire à la tribune sacrée les dangereuses ressources de l’éloquence profane ; en conseillant aux prédicateurs de suivre l’inspiration spontanée de leur cœur, selon la circonstance et le besoin, il entendait parler uniquement de ces instructions que les évêques et les pasteurs sont obligés, par le devoir de leur ministère, de faire aux fidèles. Réduites à ce seul objet, toutes les maximes de Fénelon sont éminemment pratiques. Un évêque, en effet, s’honore plus en donnant au peuple des villes et des campagnes des instructions conformes à sa simplicité et accessibles à son intelligence, qu’en aspirant à la célébrité de l’éloquence profane. Qu’apprennent au vulgaire les sermons préparés avec trop d’art et d’étude ? Les ornements oratoires n’expliquent pas les rapports du dogme avec la morale chrétienne. Ces principes ont paru fort judicieux à l’abbé Maury, et l’on peutd ire avec lui des Dialogues, « qu’on doit les regarder comme le meilleur livre didactique pour les prédicateurs, et que toutes les règles de l’art y sont fondées sur le bon sens et sur la nature. » Ces préceptes sont réduits à un petit nombre de conseils tirés d’une expérience personnelle : étudier les saintes Ecritures et les Pères de l’Église (dont Fénelon donne une appréciation nouvelle mêlée de quelques critiques, mais pleine de justesse et d’élévation) ; éviter toute recherche de style, dédaigner toute prétention aux effets oratoires et parler toujours autant que possible d’abondance. Au sentiment de M. Villemain, « nous n’avons dans notre langue aucun traité de l’art oratoire qui renferme plus d’idées saines, ingénieuses et neuves, une impartialité plus sévère et plus hardie dans ses jugements. Le style en est simple, agréable, varié, éloquent à propos, et mêlé de cet enjouement délicat dont les anciens savent tempérer la sévérité didactique… On y sent partout ce goût exquis de simplicité, cet amour pour le beau simple qui fait le caractère inimitable de ses écrits. » M. Nisard partage l’opinion de M. Villemain : « Fénelon, dit-il, s’est heureusement inspiré de cette méthode de Socrate, amenant peu à peu son interlocuteur, par la douce insinuation de la logique familière, à se dépouiller de ses préjugés et à se laisser surprendre en quelque sorte par la vérité… On peut regarder ces Dialogues comme l’un des ouvrages de critique les plus originaux dans notre langue. »
La Lettre à l’Académie française fait suite aux Dialogues sur l’éloquence.
Éloquence de la chaire (essai sur l’), ouvrage de l’abbé Maury, publié en 1810 (2 vol. in-8o). Cette édition est le livre, refondu et considérablement augmenté, des Discours choisis sur divers sujets de religion et de littérature, publiés en 1777 ; ce recueil n’était remarquable que par une profusion d’anecdotes. Souvent réimprimé à l’insu de l’auteur, qui ne l’avait destiné qu’à sa seule instruction, cet ensemble d’observations journalières lui parut présenter enfin la matière d’un traité sur l’éloquence sacrée.
L’ouvrage définitif de l’abbé Maury n’est pas une exposition aride des règles qui constituent la théorie de l’art oratoire ; l’auteur s’est proposé d’exciter le goût de l’éloquence plutôt que d’en rappeler les éléments. Son Essai est tout aussi bien une dissertation critique, accompagnée d’exemples et de jugements, qu’un traité didactique. Ce sont même ces aperçus et ces citations raisonnées des grands modèles qui intéressent la majorité des lecteurs qui veulent connaître les beautés et les défauts des chefs-d’œuvre, sans ambitionner les périlleux triomphes de l’éloquence sacréé ou profane. L’auteur cite à chaque page les orateurs du premier ordre, et surtout Bossuet ; son goût n’hésite pas à indiquer et à discuter des fautes de discours que l’autorité-d’un grand nom rendrait contagieuses. L’abbé Maury a eu l’honneur d’inventer ou de réhabiliter le P. Bridaine ; le premier, il a contesté à Massillon un rang qui lui paraît être supérieur à son mérite ; enfin, il a compris et jugé Bourdaloue comme personne ne l’a fait, ni avant lui ni après lui. Maury est le critique interprète de Bourdaloue, comme La Harpe est le commentateur éloquent et fidèle de Racine.
En perpétuant le souvenir des anecdotes historiques qui se rattachent à la tribune sacrée du xviie siècle, l’auteur s’est proposé de conserver les traditions de la chaire et de suppléer au commentaire qui manquait aux éditions de Bossuet, de Bourdaloue et de Massillon. Les orateurs nationaux ne lui ont pas fait perdre de vue les étrangers ; il s’est, borné toutefois aux plus célèbres prédicateurs de l’Italie et de l’Angleterre.
Sainte-Beuve a jugé a son tour l’abbé Maury. Sévère pour l’homme, Il ne cache pas son estime pour un traité dont l’absence ou la perte serait chose fort regrettable. « Son Essai sur l’éloquence de la chaire est un des meilleurs livres que nous ayons dans le genre didactique. Malgré le titre, et quoiqu’il soit toujours très-difficile de venir parler de sermons et de l’art d’en faire sans ennuyer, l’abbé Maury instruit et n’ennuie pas. » Sainte-Beuve dit plus loin de ce livre, corrigé et perfectionné, qui reçut sa forme définitive en 1810 : « Non-seulement les prédicateurs, mais tous ceux qui ont à parler en public y trouveront quantité de remarques justes et fines, mais justes avant tout, et qui sont d’un homme de métier, parlant avec autorité de ce qu’il a pratiqué et de ce qu’il sait à fond. L’auteur, en se remettant à cet estimable travail, s’est évidemment ressouvenu des heures appliquées de sa jeunesse, et il les a recommencées avec charme et avec fruit. Tout y est sensé, et rien n’y sent l’ennui. Le style s’y anime convenablement des citations des anciens sans trop s’en surcharger… Des souvenirs personnels, quelques anecdotes introduites à propos, viennent consoler de la continuité des préceptes sans en distraire. Les chefs-d’œuvre de la chaire sont présentés, analysés en grand, et il n’oublie pas les particularités qui peuvent en éclaircir et en faire valoir quelques effets déjà inaperçus… Ne lui demandez ni grande finesse, ni grande nouveauté, ni curiosité vive ; mais il est large, il est plein, il va au principal ; il s’entend à poser l’architecture et les grandes avenues du discours ; il les démontre en maître chez les maîtres. »
Marmontel, dans ses Mémoires, apprécie le talent oratoire de l’abbé Maury ; Palissot, dans.ses Mémoires sur la littérature, parle avec éloges de l’Essai sur l’éloquence de la chaire ; La Harpe, dans son Cours de littérature, prend à partie son confrère en critique à propos de quelques opinions qui dérangent les idées du fameux Aristarque ; Dussault, dans les Annales littéraires, a révisé ou confirmé ces divers jugements. Voici à quoi il s’en tient : « C’est un très-bon livre de littérature autant qu’un traité spécial ; et l’on ne peut le parcourir sans se sentir enflammé d’un amour plus vif pour les lettres et d’une ardeur favorable au développement du talent… Tout est fondu d’un seul jet dans le style de M. le carJinal Maury : tout est lié, tout marche d’ensemble… Dans l’abandon do son.éloquence, quelquefois un peu négligée, il se fait pardonner quelques incorrections, quelques traits d’un goût moins pur, à force de chaleur, de verve et d’intérêt : peu d’ouvrages de littérature et de critique offrent une lecture plus attachante que l’Eloquence de la chaire. »
M. Poujoulat a publié une monographie assez étendue sur la vie et les œuvres du carditial Maury, qui aurait dû rester abbé suivant la piquante remarque de Chénier.
Éloquence politique et religieuse au xive, au xve et au xvie siècle (histoire de l’), par Géruzez. C’est un recueil des leçons que ce savant écrivain a professées à la Sorbonne en 1837-1838 (2 vol. in-8o). C’est un ouvrage sagement écrit, où manquent parfois les développements, mais qui, dans son ensemble, peut servir de guide fidèle pour l’étude de l’éloquence au moyen âge et pendant la Renaissance. Les divers chapitres qui le composent ressemblent aux anneaux d’une chaîne que l’on peut nouer facilement, mais qui ne sont pas liés entre eux ; on voit que c’est là une série de leçons préparées. Chaque leçon, d’ailleurs, prise a part, est excellente. L’éloquence religieuse, politique et judiciaire, est traitée de main de maître ; la prédication de la première croisade, les sermonnaires, la comédie aristophanesque sont consciencieusement étudiés. Saint Bernard, Abélard, Alain Chartier, Rabelais, Calvin, Anne Dubourg, les pamphlétaires, d’Aubigné, sont autant de portraits réussis. L’auteur s’applique partout à établir une sorte de parenté entre la littérature grecque, la littérature latine et notre littérature : « Bodin, l’auteur de la République, est un disciple d’Aristote ; L’Hospital pense et parle comme un Caton ; de Thou est formé à l’école de Tite-Live ; Cujas et Pithou reconnaissent pour maîtres Gaïus et Papinien ; Montaigne rend hommage à Sénèque et à Plutarque, et c’est dans l’étude d’Horace et de Virgile que Régnier et Malherbe ont retrouvé la vraie poésie. » Peut-être cette préoccupation systématique entraîne-t-elle parfois M. Géruzez un peu loin ; mais il soutient toujours spirituellement sa thèse. Ce qui est rare, nous nous plaignons de la brièveté de son livre. Ainsi, nous aurions désiré voir l’auteur traiter avec plus d’énergie tout ce qui a rapport aux origines de notre éloquence parlementaire et insister davantage sur l’effet que produisirent les discours de nos premiers hommes politiques du tiers état. Que devaient dire, par exemple, les députés aux états de 1484 en entendant Jacques de Viry, juge en Forez, dresser en homme de bien, au nom de la France, cet acte d’accusation contre Louis XI, le méchant roi qui venait de mourir, et auquel M. Géruzez ne nous semble pas rendre suffisamment justice. On dirait qu’il nie à dessein ses actes de bonne politique par horreur pour sa cruauté. Jacques de Viry trace un tableau qui rappelle le sombre pinceau de Tacite, que Camille Desmoulins saura retrouver plus tard pour peindre les suspects : « Vous savez tous que naguère, du temps du roi Louis, l’état entier de l’Eglise a été déshonoré, et ses élections ont été cassées, les indignes promus aux épiscopats et aux bénéfices, les biens des églises envahis, les plus saintes personnes délaissées sans aucune dignité ; que dis-je ? abandonnées à une condition vile et ignominieuse. Il n’est pas nécessaire de rappeler à votre souvenir les délateurs et les calomniateurs de l’innocence, admis partout à la cour, revêtus de titres honorables et des offices publics, ni ces gens avides et inventeurs des nouveaux profits, préposés de préférence à la levée des impôts et placés souvent dans les plus hautes administrations ; car le plus méchant des hommes était le plus aimé, et l’on ne se contenta point de ne pas honorer la vertu et l’innocence ; on alla jusqu’à leur faire subir maintes fois le supplice du crime. N’avez-vous pas vu souvent des innocents emprisonnés sans jugement et même mis à mort, et leur héritage passer aux mains de leurs accusateurs ? Quelle a été sa prodigalité et l’excès infini de ses dépenses ? Personne ne l’ignore ; car, vous le savez, il donnait, il prenait tout sans choix et sans raison, et ses rapines n’étaient pas moins insensées que ses largesses. Quant au peuple : je dirai avec vérité que, sous ce roi de terrible mémoire, le poids insupportable des impôts faillit le jeter à bas et l’écraser. Maintenant vous paraissez vouloir que le corps de l’Etat, accablé non d’une seule maladie, déchiré non d’une seule blessure, mais accablé par un grand nombre de maladies, affaibli de mille blessures, presque mourant dans les convulsions et la langueur, se relève uniquement par vos soins et qu’il recouvre tout à coup la santé, c’est-à-dire une meilleure organisation, et qu’il remonte à son antique splendeur. Ce n’est pas chose facile ; il n’est pas dans l’ordre de la nature de guérir en quelques heures tant de blessures du corps politique, tant de difformités ; c’est par degrés, c’est à l’aide du temps qu’on effacera la trace de ces longues souffrances ! » Nous remercions M. Géruzez de remettre sous nos yeux ce morceau de mâle éloquence conservé dans le Journal de Jean Masselin, official de l’archevêque de Rouen ; mais nous le ferions bien plus chaleureusement s’il l’avait accompagné d’une sorte de photographie de l’assemblée, qui nous transmît les gestes et les expressions de physionomie à l’audition de ce langage austère. En somme, cet ouvrage de M. Géruzez est une digne introduction à son Histoire générale de l’éloquence en France.
Éloquence chrétienne au ive siècle (tableau de l’), par M. Villemain (édition refondue, 1849, 1 vol.). L’auteur s’était proposé d’écrire l’histoire de la littérature de l’Eglise naissante, de cette littérature intermédiaire, ancienne par la langue, moderne pai les idées, dont l’originalité a son charme et son prix. De cette œuvre, il n’a composé que des fragments, d’abord disséminés, puis coordonnés, développés et réunis dans un véritable livre, où l’unité du sujet est rendue plus visible. M. Villemain a retracé l’époque la plus brillante de l’éloquence chrétienne, ou du moins le tableau de la lutte morale qui, au ive siècle, a eu pour résultat de remplacer l’antique société par la société nouvelle. Il expose d abord, dans un chapitre plein de faits curieux, assemblés savamment et spirituellement commentés, le déclin des croyances du paganisme, ruinées à Rome, leur siège principal, par les hardiesses des philosophes et les inventions des poëtes, par la chute des institutions de la république, et par d’autres causes de décadence et de corruption agissant sur toutes les classes de la société. Il suit parallèlement les fortunes diverses de ces croyances dans les principales provinces de l’empire, et en marque le rapport avec les religions des peuples barbares, en dehors des limites du monde romain. Il énumère enfin et caractérise les sectes nombreuses entre lesquelles se partageait, sans s’altérer essentiellement, la religion qui, au sein d’un polythéisme universel, avait conservé la notion de l’unité de Dieu, et de laquelle allait sortir la foi appelée à régénérer le monde. Un second chapitre réprésente le progrès souterrain, l’invasion rapide des vertus du christianisme à travers la démoralisation et l’inhumanité de la société antique. Un troisième chapitre, d’un autre caractère, offre une vue générale du sujet ; il en fait comprendre la grandeur, la variété, l’originalité piquante, l’intérêt à la fois littéraire, moral et historique ; il annonce ainsi sous quels points de vue divers il doit le considérer, y cherchant tantôt l’accent d’une éloquence qui ne s’était point encore fait entendre aux hommes, tantôt la victoire d’une croyance sublime sur des philosophies rivales et des passions ennemies, tantôt la figure changeante du monde agité par ce grand débat. « Le ive siècle, dit M. Villemain dans un passage entraînant, est la grande époque de l’Eglise primitive et l’âge d’or de la littérature chrétienne. Dans l’ordre social, c’est alors que l’Eglise se fonda et devint une puissance publique ; dans l’éloquence et les lettres, c’est alors qu’elle produisit ces sublimes et brillants génies qui n’ont eu de rivaux que parmi les orateurs sacrés de la France au xviie siècle. Que de grands hommes, en effet, que d’orateurs éminents ont rempli l’intervalle d’Athanase à saint Augustin ! Quel prodigieux mouvement d’esprit dans tout le monde romain ! Quels talents déployés dans de mystiques débats ! Quel pouvoir exercé sur la croyance des hommes ! Quelle transformation de la société tout entière à la voix de cette religion qui passe des catacombes sur le trône des Césars, qui dispose du glaive, après l’avoir émoussé par ses martyrs, et n’est plus ensanglantée que par ses propres divisions ! … Dans le ive siècle, la sublimité de l’éloquence chrétienne semble croître et s’animer en proportion du dépérissement de tout le reste. C’est au milieu de l’abaissement le plus honteux des esprits et des courages, c’est dans un empire gouverné par des eunuques, envahi par les barbares, qu’un Athanase, un Chrysostome, un Ainbroise, un Augustin, font entendre la plus pure morale et la plus haute éloquence. Leur génie seul est debout, dans la décadence de l’empire. Ils ont l’air de fondateurs au milieu des ruines. C’est que, en effet, ils étaient les architectes de ce grand édifice religieux qui devait succéder à l’empire romain. » Cet imposant changement s’accomplissait dans certaines villes. L’auteur passe en revue ces théâtres fameux de l’éloquence chrétienne. Athènes, Antioche, Alexandrie, Constantinople, Rome, avec leurs populations variées, avec leurs mœurs, plus ou moins mêlées d’idolâtrie, de philosophie et de christianisme, revivent en traits frappants empruntés aux orateurs sacrés. Les écrits des Pères sont une image de l’état des esprits et du caractère propre des races. « Au milieu des controverses et des subtilités mystiques, on y surprend tous les détails de l’histoire des peuples, tous les progrès d’une longue révolution morale, le déclin et l’obstination des anciens usages, l’influence des lettres prolongeant celle des croyances, les croyances nouvelles commençant par le peuple et s’étayant à leur tour du savoir et de l’éloquence, les orateurs remplaçant les apôtres, et le christianisme formant au milieu de l’ancien monde un âge de civilisation qui semble séparé de l’empire romain et qui meurt cependant avec lui… » Là apparaissent les Pères eux-mêmes ; là se rencontrent, sans se connaître ou sans se chercher, ce Julien qui, sous les dehors suspects d’une foi imposée, médite déjà le dessein d’une restauration poétique et philosophique de l’ancien culte, et ce Grégoire de Nazianze, ce Basile, inséparables amis que les exercices de la littérature et de l’éloquence profanes préparent de loin à une gloire commune dans les travaux de la parole apostolique. Après avoir caractérisé, dans cette phase critique, le génie de l’Orient et celui de l’Occident, l’auteur introduit d’une part les Pères grecs, de l’autre les Pères latins ; il évoque les souvenirs et les œuvres de saint Athanase, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Grégoire de Nysse, de saint Basile, de saint Jean Chrysostome, de Synésius, de saint Hilaire, de saint Ambroise, de saint Jérôme, de saint Paulin, de saint Augustin. Il retrace les vicissitudes de leurs vies héroïques, repassant la longue histoire de leurs travaux, analysant leurs livres et leurs discours, complétant leurs portraits par des tableaux de moeurs. Cetie galerie critique se termine par la figure de Julien, qui tente de relever les temples ruinés du paganisme ; par celle de Symmaque, qui défend contre saint Ambroise l’autel de la Victoire. Deux chapitres, entièrement nouveaux, sont consacrés à saint Ephrem, diacre d’Edesse, et à saint Epiphane, évêque de Salamine. Ces écrivains, d’un génie tout oriental, servent de transition à certains représentants de l’Eglise latine, notamment à saint Jérôme et à saint Augustin, qui semblent appartenir à l’Orient par divers traits de caractère.
Se plaçant à un point de vue nouveau, M. Villemain a traité son sujet en dehors de toute préoccupation théologique ; il l’a considéré comme une forme particulière de la pensée et de la parole humaine. Il l’a abordé néanmoins avec un sentiment ou une émotion singulière que les critiques n’éprouvent pas d’habitude ; c’est que l’éloquence des Pères est contagieuse, qu’elle remplit le cœur d’une profonde et intime poésie, la vraie, celle qui parle à l’âme bien plus qu’à l’imagination. « Sans perdre de ses grâces d’autrefois, dit Sainte-Beuve, le talent de M. Villemain a gagné une teinte de mélancolie qu’il ne connaissait pas auparavant et qui le rehausse. On croit sentir dans ces pages toutes sérieuses, tout étendues, et où nulle trace d’inquiétude littéraire ne se fait jour, ce je ne sais quoi d’achevé que donne au talent la connaissance du mal caché et l’épreuve même de la douleur. Lorsque, la première fois, le brillant écrivain abordait ces portions d’étude si compliquées et parfois si sombres, il n’avait connu que les grâces de la vie, et il n’en avait recueilli que les applaudissements faciles. Lecteur profane, disait-il, je cherchais dans ces bibliothèques théologiques les mœurs et le génie des peupies… Pour bien apprécier le génie des Ambroise et des Augustin durant ces âges extrêmes de la calamité et de l’agonie humaine, il fallait avoir fait un pas de plus et y revenir avec la conscience qu’on n’a été soi-même étranger à rien de l’homme. C’est là le progrès à la fois moral et littéraire que je crois sentir en plus d’un passage de cette étude, devenue aujourd’hui un livre. M. Villemain n’est plus ce lecteur profane dont il a parlé. Il ne fait pas seulement briller à nos yeux