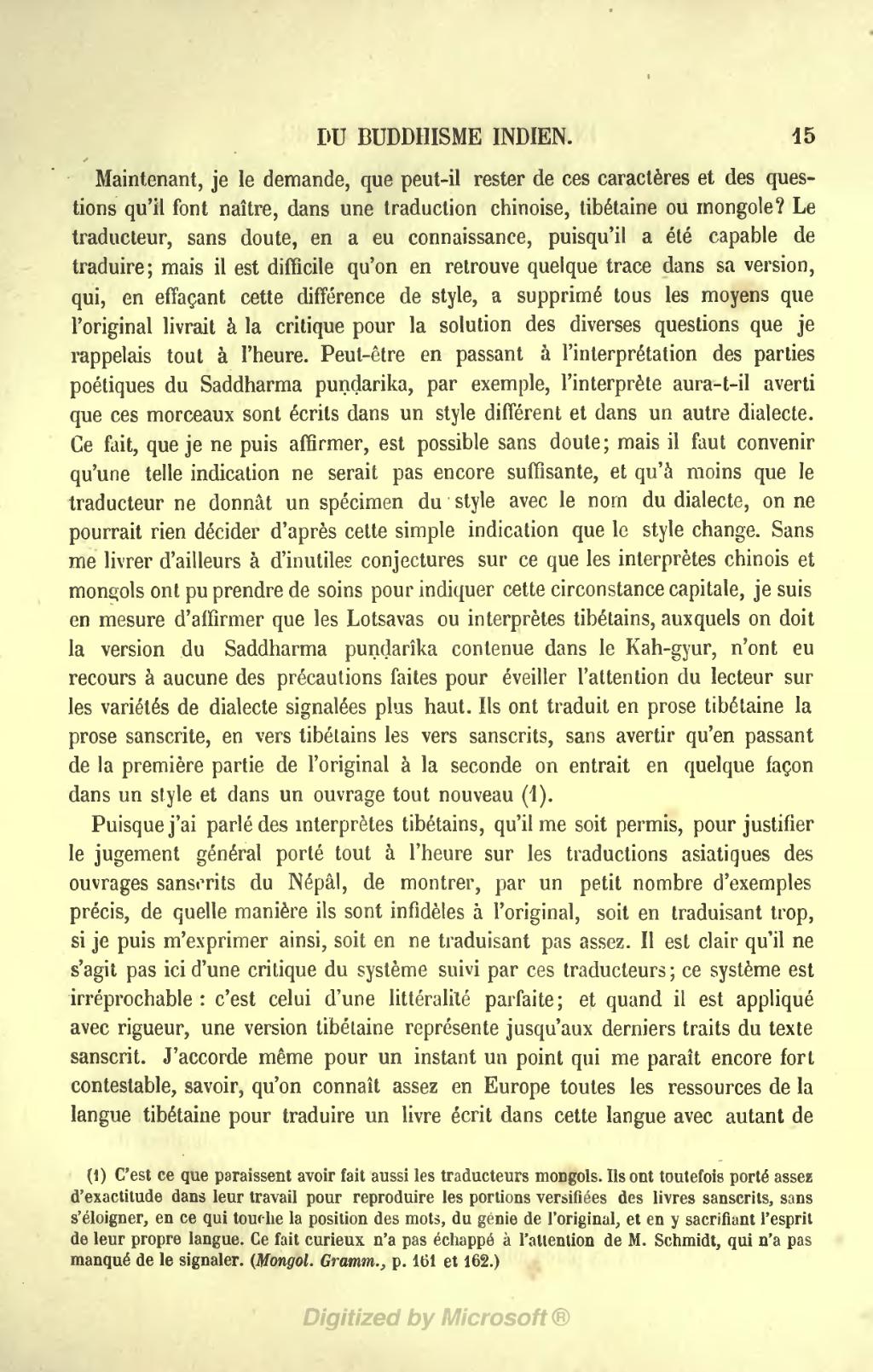Maintenant, je le demande, que peut-il rester de ces caractères et des questions qu’ils font naître, dans une traduction chinoise, tibétaine ou mongole ? Le traducteur, sans doute, en a eu connaissance, puisqu’il a été capable de traduire ; mais il est difficile qu’on en retrouve quelque trace dans sa version, qui, en effaçant cette différence de style, a supprimé tous les moyens que l’original livrait à la critique pour la solution des diverses questions que je rappelais tout à l’heure. Peut-être en passant à l’interprétation des parties poétiques du Saddharma puṇḍarika, par exemple, l’interprète aura-t-il averti que ces morceaux sont écrits dans un style différent et dans un autre dialecte. Ce fait, que je ne puis affirmer, est possible sans doute ; mais il faut convenir qu’une telle indication ne serait pas encore suffisante, et qu’à moins que le traducteur ne donnât un spécimen du style avec le nom du dialecte, on ne pourrait rien décider d’après cette simple indication que le style change. Sans me livrer d’ailleurs à d’inutiles conjectures sur ce que les interprètes chinois et mongols ont pu prendre de soins pour indiquer cette circonstance capitale, je suis en mesure d’affirmer que les Lotsavas ou interprètes tibétains, auxquels on doit la version du Saddharma puṇḍarika contenue dans le Kah-gyur, n’ont eu recours à aucune des précautions faites pour éveiller l’attention du lecteur sur les variétés de dialecte signalées plus haut. Ils ont traduit en prose tibétaine la prose sanscrite, en vers tibétains les vers sanscrits, sans avertir qu’en passant de la première partie de l’original à la seconde on entrait en quelque façon dans un style et dans un ouvrage tout nouveau[1].
Puisque j’ai parlé des interprètes tibétains, qu’il me soit permis, pour justifier le jugement général porté tout à l’heure sur les traductions asiatiques des ouvrages sanscrits du Népâl, de montrer, par un petit nombre d’exemples précis, de quelle manière ils sont infidèles à l’original, soit en traduisant trop, si je puis m’exprimer ainsi, soit en ne traduisant pas assez. Il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’une critique du système suivi par ces traducteurs ; ce système est irréprochable : c’est celui d’une littéralité parfaite ; et quand il est appliqué avec rigueur, une version tibétaine représente jusqu’aux derniers traits du texte sanscrit. J’accorde même pour un instant un point qui me paraît encore fort contestable, savoir, qu’on connaît assez en Europe toutes les ressources de la langue tibétaine pour traduire un livre écrit dans cette langue avec autant de
- ↑ C’est ce que paraissent avoir fait aussi les traducteurs mongols. Ils ont toutefois porté assez d’exactitude dans leur travail pour reproduire les portions versifiées des livres sanscrits, sans s’éloigner, en ce qui touche la position des mots, du génie de l’original ; et en y sacrifiant l’esprit de leur propre langue. Ce fait curieux n’a pas échappé à l’attention de M. Schmidt, qui n’a pas manqué de le signaler. (Mongol. Gramm., p. 161 et 162.)